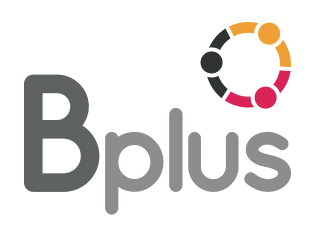La manière dont une société traite ses jeunes reflète profondément la qualité de son système démocratique. Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de la protection de la jeunesse et de l'éducation, deux domaines distincts mais intrinsèquement liés, car ils concernent directement les intérêts et l'avenir des jeunes. Cependant, les politiques de protection de la jeunesse et d'éducation peuvent également représenter un risque pour notre société et notre démocratie si elles ne sont pas exercées avec vigilance. Une approche inadéquate dans ces domaines pourrait nuire à l'égalité des chances, à la participation citoyenne des jeunes, ou encore à leur capacité à devenir des acteurs éclairés et responsables de la société. Il est donc essentiel de garantir que ces politiques restent inclusives, respectueuses des droits fondamentaux, et orientées vers l'épanouissement des jeunes pour préserver les fondements de notre démocratie.

Protection de la jeunesse
Les libertés et droits fondamentaux sont inscrits dans la Constitution ainsi que dans divers traités internationaux. Leur objectif principal est de protéger les citoyens contre les actions arbitraires des gouvernements. Bien qu'il existe des exceptions à ces principes, celles-ci semblent se généraliser progressivement, notamment dans le domaine de la protection juridique des mineurs. Qui pourrait oublier la controverse entourant les murs de verre dans le boxe des accusés lors du procès des attentats du 22 mars 2016 ? Pourtant, il apparaît que certains juges pour mineurs sont particulièrement réticents lorsque des parents invoquent les droits et libertés fondamentaux, tels que le respect de la vie privée et familiale. Cela dit, il ne s'agit pas ici de plaider pour l'abolition de ces droits dans les affaires pénales. Bien au contraire, je défends une protection égale et rigoureuse des droits de chaque citoyen, qu'il s'agisse d'un différend avec le gouvernement fédéral ou avec celui d'une entité fédérée.
Dans de nombreux débats, on évoque les interventions de grande envergure qui, souvent, se révèlent inefficaces, un phénomène désigné sous le terme d'« abus institutionnel ». Pourtant, une telle remise en question reste rare, car l'interventionnisme institutionnel est devenu la norme, quelles qu'en soient les conséquences.
Le ministre flamand compétent a souligné à plusieurs reprises l'importance des « mille premiers jours » dans le développement d'un enfant, période cruciale qui s'étend de la conception jusqu'à environ son deuxième anniversaire. Pendant cette phase, des institutions comme l'agence flamande Agentschap Opgroeien ont le pouvoir d'intervenir profondément dans la vie familiale, parfois pour des raisons jugées mineures ou discutables. Ce système, intégré dans l'accord de coalition flamand sous le nom de « surveillance de l'enfant à naître », suscite des interrogations légitimes sur son efficacité et sa pertinence. Un tel dispositif, visant des millions d'enfants dans le pays, nécessite une fonction publique immense pour répondre au moindre problème identifié. Ce débat ne se limite donc pas aux droits et libertés fondamentaux, mais inclut une dimension budgétaire incontournable dans le contexte économique actuel.
Compte tenu des récents incidents où des jeunes, manifestement en danger, n'ont pas reçu l'aide nécessaire, il est évident que le système actuel est loin d'être à la hauteur. Les scandales révélés au sein de Kind & Gezin, dont certains ont malheureusement conduit à une issue fatale, ne font qu'aggraver cette situation. Nous risquons d'être confrontés à un système à la fois coûteux et inefficace, dont les jeunes sont les premières victimes. Il est tout aussi aberrant que la protection offerte aux jeunes varie selon qu'ils vivent dans le nord ou le sud du pays. De surcroît, les procédures applicables sont particulièrement complexes, car la législation est morcelée entre différents codes et décrets (fédéraux et communautaires). Ajoutons à certaines spécificités liées à la profession juridique pour les jeunes, et nous obtenons une recette parfaite pour compromettre gravement la qualité de la défense apportée à cette population.
Certes, les avocats sont normalement autorisés à plaider sur tout le territoire belge, mais les avocats spécialisés dans la jeunesse hésitent souvent à intervenir en dehors de la juridiction de leur barreau. Cette réticence porte atteinte à la liberté de choix du client, un droit fondamental qui garantit à chacun d'être représenté par l'avocat de son choix. Par ailleurs, cette situation crée une relation malsaine entre les avocats, les institutions pour mineurs et les tribunaux pour enfants. Un autre problème préoccupant réside dans le conflit d'intérêts potentiel : il n'est pas rare que des avocats spécialisés en droit de la jeunesse siègent au conseil d'administration d'organisations sans but lucratif dans le secteur de l'aide à la jeunesse. Si un tribunal de la jeunesse ordonne qu'un jeune soit suivi par l'organisme en question, auquel appartient l'avocat désigné pour le représenter, la situation devient ambiguë. Les intérêts financiers de l'organisme sont alors en jeu, car ce suivi génère des revenus. Dans ce contexte, on peut légitimement se demander : l'avocat défendra-t-il les intérêts de son jeune client ou ceux de l'organisme dont il dépend ? Cette situation est d'autant plus alarmante que les jeunes, par définition immatures, sont particulièrement vulnérables aux abus. Qui les protège dans ce cas précis ? Le scandale des allocations familiales aux Pays-Bas montre que ce type de dysfonctionnements institutionnels peut rapidement prendre une ampleur considérable. En Belgique, nous courons un risque similaire, d'autant plus que certaines institutions publiques responsables de ces problématiques semblent évoluer vers une forme d'"État dans l'État", comme en témoigne le rapport systématique des indemnisations dues aux familles affectées par des décisions administratives erronées. Face à ces défis, il est impératif de recentraliser les aspects procéduraux du droit de la protection de la jeunesse au niveau fédéral. Les enfants belges, qu'ils vivent au nord ou au sud du pays, ont droit à une procédure unifiée, simple et transparente qui garantit leurs droits constitutionnels ainsi que ceux de leurs parents. Ils doivent également pouvoir présenter leur cas devant un juge indépendant et impartial, condition essentielle pour assurer la justice. Le ministre fédéral de la Justice a ici un rôle crucial à jouer. La création d'un « code fédéral de procédure pour mineurs » constitue une solution indispensable pour apporter la clarté et la protection nécessaire dans ce domaine.
L'éducation : le dindon de la farce ?
Les projets éducatifs récemment présentés lors des négociations pour la formation du gouvernement flamand, combinés aux rapports alarmants sur la qualité de notre système scolaire, m'incitent à aborder ce sujet crucial. Ces négociations ont révélé des propositions centrées sur une étatisation accrue, accompagnée de contrôles et de sanctions. Pourtant, les défis bien connus de l’éducation, notamment la baisse de qualité, n’y trouvent aucune réponse. Ce type d'approche reflète une mentalité autoritaire que l'on pourrait qualifier de "despotisme éclairé", et qui semble influencer certains milieux.
L'une des mesures évoquées, à savoir remplacer les organisations faîtières par une éducation entièrement publique, menace gravement la liberté de choix des familles. Cette uniformisation risquerait de conduire à un appauvrissement intellectuel profond, ce qui, à mon sens, constitue un enjeu encore plus préoccupant. Nos jeunes représentent notre richesse la plus précieuse, et il est inadmissible de traiter leur avenir avec autant de légèreté.
La dégradation de la qualité éducative atteint un niveau inacceptable. Opter pour une homogénéisation du système ne fera qu’aggraver ce problème. De plus, un excès de contrôle et des sanctions risquent de démotiver encore davantage les écoles, les enseignants, les parents et les élèves, dont les appels à l'aide restent vains dans leurs plaintes et demandes d'aide justifiées
Face à ces projets inquiétants, je vous invite à rester vigilants et à être prêts, si nécessaire, à défendre activement la liberté des parents, des jeunes et des écoles. Cette liberté est un pilier fondamental de notre société.
Rappelons-nous que notre région a autrefois résisté au despotisme de Joseph II. De même, la Belgique, parfois dénigrée sous l'appellation de « Belgique de papa », fut autrefois privilégiée pour sa constitution libérale, née en grande partie de l'opposition à l'étatisme de Guillaume Ier. À l'époque, sa politique éducative était une des principales sources de mécontentement, mobilisant particulièrement le pilier catholique.
Les droits et libertés fondamentaux ont pour vocation de protéger les citoyens contre les dérives de l'État. Il est grand temps d'en revenir à cette conscience collective. À mon avis, le contexte belge, où coexistent les sensibilités flamandes et wallonnes, constitue un terrain idéal pour préserver cet équilibre.
En conclusion
La politique actuelle de protection et d'éducation de la jeunesse repose principalement sur la surveillance, le contrôle et la sanction, souvent au détriment de l'efficacité et de la rentabilité. Les jeunes en sont les premières victimes. Bien que la protection de la jeunesse soit parfois perçue comme bienveillante, elle ne propose pas l'aide appropriée et peut même enfreindre les libertés et droits fondamentaux dans plusieurs domaines. Par ailleurs, la qualité de notre système éducatif, qui était jadis très admirée, se dégrade, et la réponse systématique semble être davantage de contrôle et de répression. Une solution envisageable pourrait être de refédéreraliser certaines compétences, comme les procédures judiciaires en matière de droit de la jeunesse.