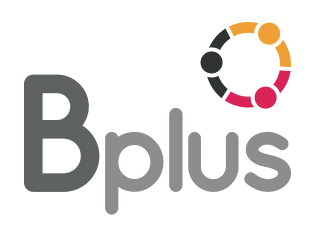En septembre 2024, la journaliste Nicole Burette a publié un essai consacré à ce qu’elle perçoit comme une mainmise illégitime de la Flandre, non seulement sur l’État belge, mais aussi sur la société et l’économie belges en général. Après un bilan de la situation, elle tente de formuler des explications et propose quelques réflexions pour l’avenir de la Belgique, et plus particulièrement des Francophones au sein de celle-ci. L’ouvrage a bénéficié d’un certain écho dans la presse francophone ; B Plus en a pris connaissance à son tour.
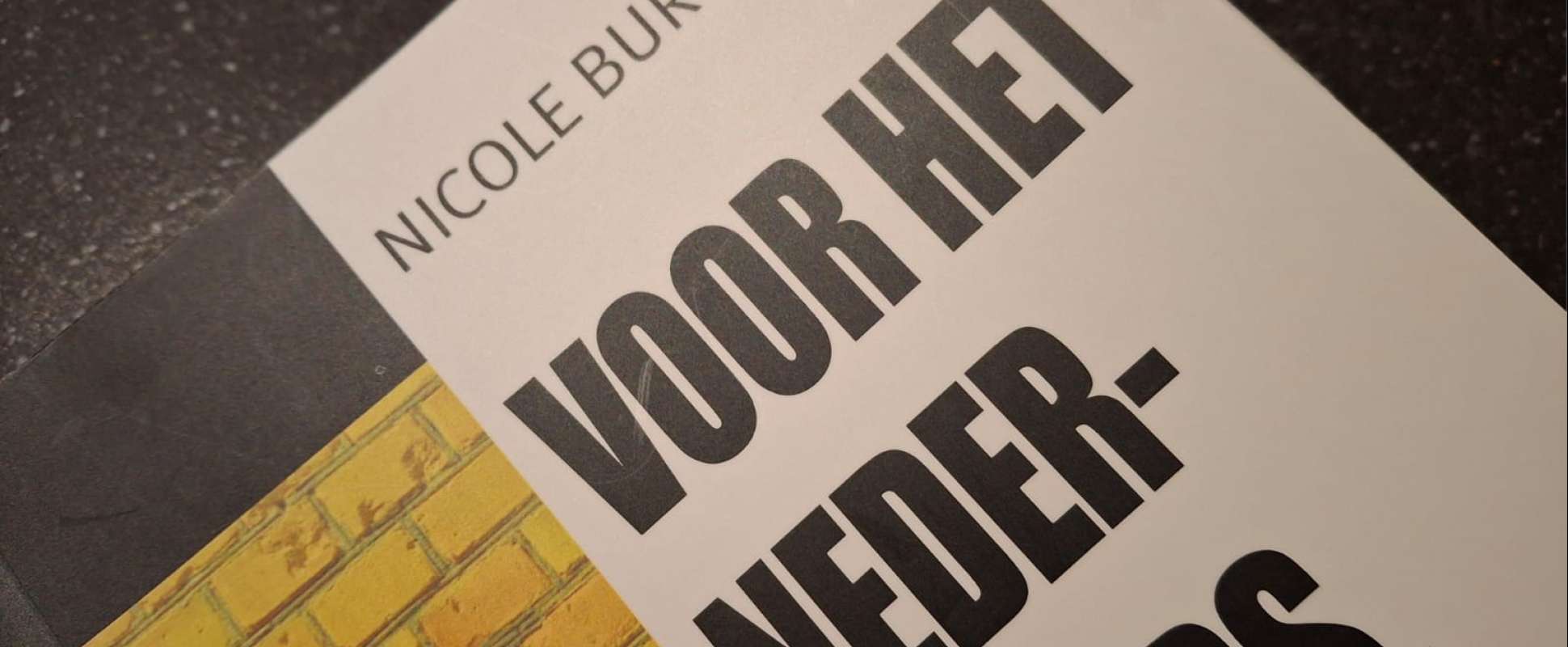
Le constat et sa méthode
Les premiers chapitres de l’ouvrage dressent un constat : depuis des années, la Flandre a pris le dessus dans le ménage belge. Forte de son poids démographique et de sa supériorité économique, elle parvient à imposer aux Francophones de Wallonie et de Bruxelles sa vision des choses et de la Belgique, sans rencontrer de réelle résistance. Non contente de façonner la Belgique à sa manière, elle profite outrageusement de ses ressources en colonisant l’appareil d’État, mais aussi de nombreuses organisations privées.
S’il est possible de souscrire à nombre des affirmations de l’auteur, la méthodologie utilisée laisse parfois songeur. Plus qu’un ensemble argumenté, les premiers chapitres de l’ouvrage font penser à un cri du cœur chargé d’émotion, plus qu’à une analyse rigoureuse de la situation. Constater le recul, voire la marginalisation, des Francophones et de leur langue en Belgique est une chose. Mettre sur le même pied la marginalisation du français dans certaines administrations (p. 27-34 , où l’on ajouterait volontiers la qualité rédactionnelle lamentable de la version française de la législation fédérale), les investissements de la SNCB (p. 45-46 et p. 81-84), et la langue maternelle du personnel d’un célèbre restaurant ardennais (p. 43) prête plutôt à sourire. On peut aussi regretter le nombre d’approximations dont ces chapitres sont truffés.
Les prétendus transferts Nord-Sud
Beaucoup plus convaincant est le chapitre consacré aux transferts financiers Nord-Sud si souvent invoqués par les nationalistes flamands pour justifier leurs revendications d’autonomie. Mme Burette remet ces transferts doublement en perspective : historique et actuelle. La mise en perspective historique est déjà bien connue. Jusqu’en 1960, c’est la Wallonie qui a soutenu financièrement la Flandre rurale, avant que le vieillissement du tissu industriel oriente les investissements vers la Flandre et son ouverture sur la mer. Plus actuelle est la réflexion sur la valeur internationale des marques « Belgique » et « Bruxelles » dont la Flandre profite allègrement aujourd’hui, quitte à effacer la composante francophone du pays (p. 91-94 et p. 111-118). Elle permet de placer plus qu’une nuance au discours nationaliste sur une Wallonie paresseuse dont la Flandre travailleuse devrait assumer le poids.
Le bilinguisme
Les premiers chapitres de l’essai suscitent quelque déception. Le lecteur se croirait face au miroir d’un pamphlet nationaliste flamand, offrant, sur le ton de Caliméro, une longue énumération des injustices subies par les Francophones dans un pays où ils ne se sentiraient plus chez eux. Ceci n’est pas sans rappeler la thèse des « deux minorités opprimées » de Dave Sinardet (Sinardet, D. (2007). Het samenleven van twee onderdrukte meerderheden: Vlamingen, Franstaligen en de media in G. Buelens, J. Gossens, & D. V. Reybrouck (Eds.), Waar België voor staat: een toekomstvisie (pp. 25-38). Meulenhoff/Manteau). On désespère un peu d’un tel chapelet de reproches adressés à l’autre communauté sur une base qui semble plus émotionnelle que rationnelle.
Heureusement, la suite de l’ouvrage prend une tournure plus constructive, avec une analyse des causes de la marginalisation du français et des Francophones. La première cause pointée du doigt par Nicole Burette est le manque de bilinguisme de trop de Francophones. Dans toutes les instances à vocation fédérale, la maîtrise des deux principales langues nationales est un must. B Plus, qui milite depuis longtemps pour rendre le néerlandais obligatoire dans les écoles de Wallonie, ne peut que se joindre à cette analyse (p. 126-129). Plus interpellants sont cependant les passages du livre qui suggèrent que cette exigence de bilinguisme est souvent hors de propos et qu’il conviendrait de prévoir « une représentation minimale » des Francophones dans les instances dirigeantes des services publics et des entreprises (p. 96-100). Qu’en 2024, une journaliste de la génération de Mme Burette en soit encore à revendiquer comme un « droit à l’unilinguisme » pour les hauts fonctionnaires francophones est profondément navrant.
Balayer devant sa propre porte
Fort opportunément, l’auteur invite les dirigeants francophones et wallons à ne pas attendre les diktats flamands pour balayer devant leur propre porte. Il est en effet trop facile d’imputer le retard économique et politique de l’espace francophone à la seule malveillance de leurs homologues flamands. Ce débat jamais tranché entre la priorité à accorder aux régions ou à la communauté met les Francophones dans un état de paralysie politique qui ne profite à personne, sauf aux partis politiques lotissant lesdites institutions de leurs affidés. Obésité institutionnelle et morcellement des compétences rendent impossible toute action politique efficace et cohérente. Il serait malvenu d’en blâmer les Flamands.
De même, leur désintérêt croissant pour les enjeux bruxellois et fédéraux ne met pas les dirigeants francophones en état intellectuel de faire valoir leur point de vue légitime face à des négociateurs flamands bien mieux préparés. N’est-il pas ironique que ce soit au sein des partis flamands, souvent taxé à tort ou à raison de nationalisme, que soient menées les réflexions de fond sur le niveau fédéral, alors que les partis francophones, soit-disant attachés à la Belgique, ne semble guère s’en soucier ? N’est-il pas invraisemblable que les universités francophones ne considèrent toujours pas comme indispensable d’être bilingue pour s’occuper de droit constitutionnel (p. 145) ?
Perspectives
L’ouvrage s’achève sur différentes perspectives d’avenir à propos de la Belgique et de la place des francophones en son sein. Parmi les recommandations formulées par Nicole Burette aux dirigeants francophones, deux méritent principalement le soutien de B Plus : investir davantage dans l’apprentissage du néerlandais et sortir de la position du Francophone « demandeur de rien ».
Il n’est pas crédible de se proclamer son attachement à la Belgique si on ne fait pas d’effort pour apprendre la langue de la majorité de ses concitoyens. Tant que les Francophones ne maîtriseront pas mieux le néerlandais, il se feront écarter des fonctions qui comptent en Belgique. Pire encore, leur incohérence donnera des arguments à ceux qui, en Flandre, souhaitent la disparition de ce pays.
La Belgique a besoin de réformes. L’architecture institutionnelle actuelle n’est ni efficace, ni efficiente. Les institutions bruxelloises doivent être rationalisées et il ne sert à rien de nier les problèmes actuels qui sont de plus en plus criants. Le fédéralisme doit être amélioré : il faut instaurer une circonscription fédérale et une hiérarchie des normes. Il faut oser parler de la répartition des compétences, aussi pour exiger des refédéralisations là où elles sont nécessaires. Mais cela nécessite le courage intellectuel de voir les problèmes en face et de réfléchir à des solutions constructives : pas contre les Flamands, mais pour la Belgique. À cet égard, les militants de B Plus qui prendront la peine de lire la prose de Nicole Burette apprendront qu’au moins un président de parti francophone est à la fois partisan de l’apprentissage obligatoire du néerlandais, d’une hiérarchie des normes, de refédéralisations, et de rationalisations institutionnelles intra-francophones.
N. Burette, Voor het Nederlands, druk één. Pour le français, tapez deux…, Couleurs Livres, Mons, 2024.