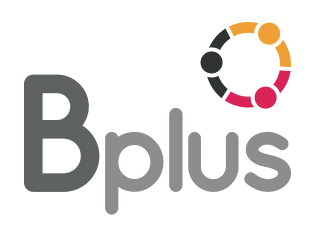La scission de l’assurance maladie ne résout aucun problème structurel, mais mine la solidarité et la mutualisation des risques, plaident Tom Zwaenepoel, Christian Deneve et Jean Hermesse dans "De Tijd" du 12 mai 2025. Ce n’est pas l’assurance maladie fédérale qui pose problème, mais bien la répartition complexe des compétences dans l’organisation des soins. La refédéralisation offre justement l’échelle, l’efficacité et la cohérence dont notre système de santé a aujourd’hui un besoin urgent.

Notre système de santé ploie sous une pression croissante. Les temps d'attente s'allongent, de plus en plus de jeunes souffrent de dépression, le personnel soignant décroche, les patients ne trouvent plus de médecin généraliste et les médicaments deviennent plus chers. Dans le même temps, la population vieillit, surtout en Flandre. Ce sont là des fissures structurelles dans un système qui a été morcelé pendant des années. Dans ce contexte, l’appel à une scission de l’assurance maladie ressemble à une fuite en avant – alors que c’est justement plus de cohérence qu’il nous faut.
L'appel récemment lancé par Jürgen Constandt, président du Vlaams en Neutraal Ziekenfonds (Mutualité flamande et neutre), dans De Tijd en faveur d'une scission de l'assurance maladie et invalidité est symptomatique d'une croyance tenace – mais totalement erronée – selon laquelle la scission des compétences pourrait résoudre des problèmes aussi complexes. Comme si six millions de Flamands pouvaient obtenir de meilleurs prix pour les médicaments que onze millions de Belges. Comme si les patients et le personnel soignant ne circulaient pas au-delà des frontières régionales. Et comme s’il n’existait que des Flamands jeunes et en bonne santé et des Wallons âgés et malades. Non seulement c’est non seulement faux, mais en plus la Flandre vieillit plus vite que la Wallonie et Bruxelles. Les rôles sont en train de s’inverser – et la surconsommation flamande viendra alors d’elle-même.
Les partisans d’une sécurité sociale scindée décrivent le système fédéral comme un mécanisme où les Flamands verseraient chaque année une somme d'argent à un Wallon ou un Bruxellois. Constandt illustre cela en déclarant qu’un Wallon coûte en moyenne 3.004 euros par an à l’assurance maladie, contre 2.900 euros pour un Flamand. Premièrement, cette différence peut s’expliquer en partie par des facteurs démographiques (population plus âgée ou plus grande prévalence de maladies chroniques). Deuxièmement, ce raisonnement est économiquement incorrect. Les cotisations des travailleurs et des employeurs ne sont pas des versements individuels, mais des contributions collectives dans un système redistributif. La solidarité, y compris en cas de maladie ou d’invalidité, va des riches vers les pauvres, des bien-portants vers les malades, des jeunes vers les personnes âgées.
Pour y répondre, deux évidences s’imposent dans le monde de l’assurance : mutualiser les risques entre le plus grand nombre de citoyens possible, et rechercher l’efficacité par des économies d’échelle. C'est précisément cela que le système fédéral permet.
Une scission entraînerait en outre des coûts supplémentaires (administration doublée et perte de mutualisation des risques), ainsi qu’un morcellement accru de la politique des soins. Bruxelles, évoquée par M. Constandt, et sa complexe structure politique (produit dypique de la religion de la scission), en est d’ailleurs un exemple parlant.
Malgré ces nuances, on laisse entendre à répétition que les défaillances du système de soins en Wallonie et à Bruxelles seraient dues à une prétendue "culture collective de la santé", financée par le fruit du labeur flamand. Mais ceux qui réduisent la réalité de terrain à de tels clichés ne font qu’attiser la polarisation communautaire. Les habitants de ces régions sont ainsi collectivement stigmatisés – et la scission des soins de santé serait censée apporter une solution.
Où se situe réellement le problème ? Ce n’est pas dans l’assurance maladie fédérale, mais dans la répartition complexe des compétences concernant l’organisation des soins. Ainsi, la prévention est une dépense pour les communautés, alors que ses effets positifs contribuent à maîtriser le budget fédéral de la santé. Les hôpitaux sont financés en partie par le fédéral et en partie par les communautés, ce qui empêche l’émergence d’une vision commune. Bruxelles réduit le nombre de lits en maison de repos, tandis que la Flandre les multiplie – à quelques kilomètres de distance.
Les solutions qui paraissent simples ne rendent souvent pas justice à la complexité de la matière sanitaire, surtout lorsque la solidarité interpersonnelle et l’efficacité sont en jeu. C’est pourquoi nous plaidons pour une refédéralisation qui combatte le morcellement et restaure la cohérence. Ce n’est pas une simplification, mais une condition essentielle pour soutenir efficacement, à partir d’un cadre unique, les réseaux locaux comme les zones de première ligne ou les structures hospitalières.
La société elle-même le réclame. Selon un sondage Ipsos de 2020, 71 % des Belges – y compris une majorité d’électeurs du Vlaams Belang et de la N-VA – sont favorables à une refédéralisation. Ce chiffre atteint même 85 % parmi les directeurs d’hôpitaux. En 2021, ces chiffres ont été confirmés par un sondage organisé par la VRT : 86 % des Flamands souhaitaient plus de Belgique ou une refédéralisation complète.
Un tel soutien constitue un solide mandat pour une réforme de l’État.
Tom Zwaenepoel est rhumatologue chez AZorg et membre du comité de direction de B Plus.
Christian Deneve est ancien directeur général au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale et professeur émérite à la VUB.
Jean Hermesse est ancien vice-président des Mutualités chrétiennes.